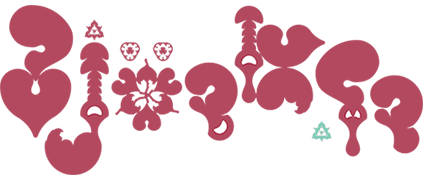Un disque sur deux, Björk va un peu plus vers l’audace. Un disque sur deux, Björk s’en retourne un peu plus près vers quelque norme plus tolérable pour le grand public. Voilà pour le schéma, bien ancré dans les têtes, que n’ont pas manqué de déjà nous resservir nombre de voix à propos de Fossora, son onzième album, qui sort ce vendredi. Pourtant le boniment est très peu satisfaisant pour qui suit vraiment l’Islandaise. Le fait est qu’elle ne cesse d’avancer dans son monde. Un monde à la cosmogonie désormais bien établie, où les arbres sont des machines, les cœurs des cathédrales et les robots unis entre eux, et à nous, par des liens intimes qui sont bien plus que de la cohabitation.

Atterri cinq ans après Utopia, disque de l’air et des cieux, voilà ainsi Fossora, album poussé au fond d’une vallée, juste sous la surface de l’humus. Disque futuriste – dans le sens où toute œuvre d’art, comme l’explique dans Dark Ecology son ami le philosophe Timothy Morton, nous parle depuis les temps à venir –, Fossora voit l’Islandaise, 56 ans, prendre fait et cause pour les spores et les champignons, ces êtres interconnectés, à mi-chemin du vif et de l’inerte, existant de la plus petite échelle à la plus immense. Et que lui inspirent les fongus ? Un disque à la vivacité inédite et à l’invention tentaculaire, où tout dans sa musique, rythmes, arrangements, refrains, semble avoir été réinventé selon cette forme du vivant susceptible de toutes les audaces, de la parade florale au parasitisme le plus dissimulé. Vaste ensemble de compositions interconnectées pour chœurs, vents, cuivres, cordes frottées ou piquées, sampler et poésie chantée, Fossora est un disque qui joue avec les traditions avec une désinvolture à la limite de la profanation, presque dénué de forme et de colonne vertébrale, si ce n’est ces beats électrisés qui viennent ponctuellement soutenir les escalades de notes à l’intersection de la comptine d’enfance, de la chanson populaire et de la symphonie atonale.
On a déjà dit aussi que le disque embrassait l’influence du gabber, cette forme de techno très rapide née au début des nineties aux Pays-Bas, mais il faut préciser qu’il est d’abord le fait de l’Indonésien Kasimyn, qui le fait voguer sur les tempos ancestraux des gamelans, et que Björk, toujours joueuse, se réfère au mot « gabba », qui en vieil islandais signifie « celui qui se moque », comme elle ne manque de le souligner avec le démoniaque instrumental Trölla-Gabba. Pour comprendre, ou sentir plutôt, où Björk veut en venir, il faut la suivre dans son propos, fredonné ou hurlé avec une invention rythmique qui n’a d’équivalent que dans la composition contemporaine la plus avancée, et qui lie dans les mêmes phrases les mycéliums et la cime des arbres, l’univers à la terre dans laquelle elle a récemment enterré sa mère, Hildur Rúna, à laquelle elle consacre à la suite une eulogie (Sorrowful Soil) et une épitaphe (Ancestress). D’autres membres de sa famille, son fils Sindri Eldon et sa fille Isadóra Barney, complètent d’ailleurs cet album tout entier dévoué à l’interconnexion et à la coexistence, son plus intense depuis longtemps, dont elle nous parle à distance, avec attention et passion, comme une évidence.

Je dois vous avouer avoir rêvé de cet entretien.
Oh ? Mais que se passait-il dans votre rêve ?
Vous disiez que c’était paradoxal de se parler de ce disque à distance. Ce matin, j’ai compris pourquoi. C’est un disque sur l’interconnexion.
Il y a du vrai. Mais si je devais voyager pour rencontrer tous les gens à qui je parle à chaque fois que je fais un disque, si je les faisais tous venir à moi, je ne pourrais pas parler à autant de gens… Et ça serait une grosse dépense écologique (rires). Mais j’aime le téléphone. J’aime marcher en parlant. Souvent, je passe les coups de fil sur la plage et je fais des allers-retours furieusement. Et puis il y a eu la pandémie, nous nous sommes tous habitués. J’avais du mal avec ces entretiens à distance avant. Moins maintenant.
Puis-je vous demander d’où vous nous parlez cet après-midi ?
Je suis dans ma maison. Je vis au bord de la mer. C’est un jour d’automne pluvieux, les feuilles des arbres sont en train de devenir orange, ça devient très agréable de rester à la maison et d’enfiler des habits plus chauds.
Les champignons ont-ils commencé à pousser ?
Oui ! Et les Islandais s’y intéressent de nouveau. Pendant des générations, on n’allait plus les cueillir. Ça revient. Dans les librairies, on trouve de nouveau des livres sur les champignons bons à manger ou vénéneux. Pourtant, il y a des preuves archéologiques : nous mangions énormément de champignons autrefois.
Pourquoi ?
Nous avons mis beaucoup plus de temps que les autres pays européens à nous adapter aux modes de vie moderne. Nous avons abandonné beaucoup de traditions presque du jour au lendemain, comme ramasser des algues sur la plage pour les consommer. J’ai l’impression que c’est en train de revenir. Les jeunes générations se passionnent pour le sujet.
La pandémie a-t-elle joué dans cette évolution ?
Ça a commencé avant. Je dirais après ce moment où les Islandais ont commencé à se sentir faire partie de la communauté mondiale. Beaucoup d’écrivains, d’artistes, de musiciens, ont porté cette revendication, « je ne suis pas un citoyen du monde de seconde classe ». Une fois que nous avons gagné cette cause, et grâce à la prise de conscience écologique, il est devenu clair que tout n’était pas bon à prendre dans l’Occident. La relation des Occidentaux à la nature notamment, est peut-être… fucked-up [délirante, ndlr], ou tout du moins plus très porteuse d’avenir ni de succès.
Cette jeune génération dont vous parlez fait penser que Fossora, plus que n’importe lequel de vos albums précédents, est un disque sur l’avenir.
Il y a deux semaines, ici en Islande, on rassemblait les moutons pour l’hiver. Nous n’avons jamais sacrifié la nature au nom de la modernité. Fossora, pour moi, est un disque très réaliste. Utopia, était un album de science-fiction. Fossora, c’est ma manière de prendre en compte ce que j’ai, ici et maintenant, et de m’en satisfaire. Pendant que j’écrivais les chansons, j’ai vendu mon appartement à Brooklyn. Et j’ai rapatrié tout ce que j’y avais entreposé par conteneur. Je peux dire que pour la première fois depuis les années 90, quand j’ai commencé à vivre à Londres, toutes mes possessions sont rassemblées dans la même maison. Ça me procure un plaisir fou. Fossora parle de concentrer tout son être, ceux qu’on aime, ses possessions en un seul lieu et y trouver une sorte de félicité.
Utopia était un disque céleste, un sentiment que l’on connaît bien en musique, puisque toute la musique religieuse est en quelque sorte céleste. Une musique de la terre est beaucoup plus rare.
Connaissez-vous Cyrillus Kreek, le compositeur estonien ? Sa musique chorale, pour moi, est incroyablement terrienne. Ou la musique électronique de Jlin, qui fait du footwork. Dans les années 80, c’était peut-être Public Enemy, dont je jouais les disques à fond, toute la journée. Je me demande à quoi rime cette playlist que je viens de vous faire (rires). Attendez, j’y pense. Il y a ce disque incroyable de Louise Bourgeois qui chante des comptines pour enfants, en français [c’est le Murmure de l’eau qui chante]. Elle devait avoir un peu plus de 70 ans. On l’entend fumer entre les chansons. Et elle a cette voix incroyable (elle l’imite). Je ne connais pas de voix plus terreuse que ça ! Ça m’a énormément touché de découvrir ce disque. Elle documente le moment où l’on perd sa voix. On connaît beaucoup de chanteurs qui ont enregistré jusqu’à tard dans leur vie. Moins les femmes.
Fossora est aussi terrien dans le sens où il grouille d’organismes sonores, qui semblent vivre chacun dans leur coin au moins autant qu’ils interagissent.
Il y a deux choses. La première, c’est l’atterrissage, après Utopia. A l’époque où j’enregistrais ce disque, je savais que ça ne durerait qu’un temps. C’était une période extatique, mais comme un rêve éveillé. Tous les rêves ont une fin. Ensuite, j’ai travaillé un peu différemment. J’ai l’habitude de composer en marchant, avec un petit software qui simule un son de harpe, pour m’accompagner au chant. Cette fois, j’ai surtout joué avec les accordages. Je me suis aussi beaucoup amusée à manipuler ma voix. Comme sur Mycelia ou sur Ovule. J’ai chanté des notes sur quatre octaves, en prononçant plusieurs types de son, « a », « ou », « mmmh », puis je me suis installée dans ma cabane, qui est adossée à la montagne, et j’ai travaillé à m’échapper des enchaînements d’accords qui m’étaient les plus familiers.
On entend dans ce disque les harmonies les plus complexes que vous ayez jamais composées.
Oui ! On peut dire qu’elles sont « terreuses » ou, d’une manière plus traditionnelle, chromatiques et irrégulières.
Le phrasé est aussi beaucoup plus libre que dans vos chansons passées. Plus proches de la musique contemporaine que de la pop.
La pandémie m’a autorisée à m’offrir un cadeau merveilleux : du temps. J’aurais pu finir ce disque il y a deux ans. Mais j’ai décidé de changer de rythme. Il n’y avait plus de concert nulle part. Alors si je travaillais tout de même, à composer, enregistrer, j’attendais entre les sessions de travail. Parfois plusieurs semaines si j’avais le sentiment que c’était nécessaire. Et pendant ce temps-là, la musique s’est développée de manière inattendue. Quand on est absolument reposée, on est plus libre. Je vais vous donner un exemple. J’ai commencé à écrire et composer Ovule quand j’étais à Lanzarote. La chanson était pas mal. Je me souviens la chanter dans la cabine de douche de mon Airbnb, qui avait une réverbération géniale. Mais je savais qu’elle ne sonnerait jamais aussi bien sur un disque que dans cette douche. L’année dernière, j’ai passé une semaine entière sans boire de café ni d’alcool. Au bout de cette semaine, j’ai complètement refondu la chanson. Elle est bien meilleure désormais. Tellement plus libre. Aussi bonne qu’à Lanzarote.
Vous sentez-vous plus libre aujourd’hui que par le passé ?
Je comprends ceux qui disent qu’en vieillissant, on embrasse la possibilité de ne plus rien en avoir à foutre de ce que pensent les autres. Pas que je me préoccupais beaucoup des avis des autres avant, mais je m’en préoccupe encore moins aujourd’hui. Le fait de revenir à plein temps en Islande, aussi… J’ai fait une série de podcasts avec des amis [Sonic Symbolism], pour laquelle j’ai dû visionner à nouveau des vieilles interviews de moi… Une torture. Mais j’ai été surprise de voir que je dis toujours la même chose à la fin : « Est-ce que je peux rentrer à la maison ? » Voilà, Fossora, c’est le disque où je me dis à moi-même « oui, tu peux rentrer chez toi ».
Pensez-vous que l’influence de Fossora est plus localisée ?
Les chansons d’amour, comme Freefall ou Atopos, sont inspirées par le pays de l’amour, qui est partout et nulle part à la fois. Pas besoin de GPS. Les chansons sur ma mère sont très liées à l’Islande, évidemment. La collaboration avec Kasimyn, de Gabber Modus Operandi, a des racines ici et en Indonésie. J’ai édité ses rythmes, qui doivent composer la moitié de l’album, ici. J’étais, dans ma cabane, à m’éclater pendant que le soleil tapait à la fenêtre, la nature hurlait sa beauté jusque devant la porte. L’énergie de l’été islandais est dans ces rythmes. C’est difficile à comprendre pour certains, quand je dis par exemple que le rythme de Pluto [sur Homogenic, sorti en 1997] est comme le son d’un volcan. On me répond que la techno est urbaine. C’est vrai ! Mais pour moi, elle est rurale.
De plus en plus d’artistes commencent à réfléchir à un art pour un futur d’où l’humain serait absent. Pourrait-on dire que dans Fossora, vous cherchez un équilibre entre cette apocalypse, et un humanisme profond malgré tout ?
Désolée de revenir à l’Islande, comme si c’était un paradis – parce que je ne le pense sincèrement pas. Mais après avoir vécu dans d’autres pays, je pense que j’ai le droit de partager ce savoir que j’ai désormais. Nous sommes des animaux. Nous faisons partie de la nature. Avec le défi écologique qui se présente à nous, nous avons un savoir qui va s’avérer précieux à partager. Les solutions existent. Je viens de lire le nouveau livre de Greta Thunberg, que j’ai eu la chance d’avoir avant qu’il soit publié. Elle a parlé à cent des plus grands scientifiques du monde pour rassembler des solutions, sur le captage de CO2, l’énergie solaire, les éoliennes. Et tous évoquent une meilleure cohabitation avec la nature. Ça sera plus facile, avec ou sans la technologie.
Il fut une époque où vous étiez parmi les stars de la pop les plus accomplies du monde. Est-ce que le grand public vous intéresse encore ?
Mes goûts restent très spécifiques. Certains parlent de musique électronique expérimentale, je préfère parler de musique traditionnelle du XXIe siècle. Et je reste obsédée par des artistes comme Kelela, mon amie Arca, Coucou Chloe. Et vous avez raison, je me fiche d’être numéro 1 dans tel ou tel pays, ou partout dans le monde en même temps. Ceci dit, je n’ai jamais vraiment essayé d’être en haut des charts. De mon point de vue, rien n’a vraiment changé. Les gens oublient que sur Post, il y avait Cover Me ou Headphones. Sur Debut, il y avait The Anchor Song ou Aeroplane. J’adore le sucre, j’adore la pop, une bonne chanson de Beyoncé. En même temps, je suis toujours ce qui se passe dans la création contemporaine. Je pense être fidèle à moi-même en suivant cet équilibre. J’ai toujours été comme ça, à refuser de prêter allégeance à l’un ou à l’autre. J’ai toujours refusé le moindre compromis. Et je mesure ma chance dans le fait que les gens continuent à me suivre précisément pour cette raison. J’essaye de ne pas foutre tout ça en l’air. Je dois protéger cette intégrité pour moi, et pour les autres.