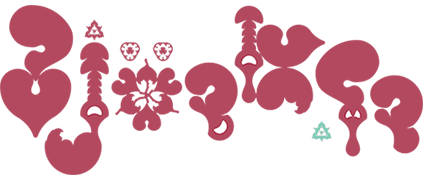Première partie : Leila Arab
Critique
La barde islandaise s’est produite lundi à Caprices, avant le sorcier électronique Amon Tobin. Deux propositions expérimentales, mais rassembleuses
Elle vient sur scène avec des cheveux fous comme la flamme, faire face aux voix aqueuses d’un chœur intégralement féminin. Plus haut, de curieuses orgues de bois mélangent leurs souffles. Et puis les rythmiques, mi-synthétiques mi-acoustiques, font gronder des sous-sols de pierres lourdes, quelque part entre les plaques tectoniques. Le feu, l’eau, l’air et la terre. Quatre éléments, pour une éternelle prêtresse des lendemains musicaux. Lundi au Caprices Festival de Crans-Montana, Björk déployait sa pop qui n’en est pas vraiment une, essaimait ses refrains en quinconce, instinctifs mais jamais intuitifs. La chanteuse se veut comme la nature : familière, imprévisible. Depuis toujours, c’est sa force et son artifice.
Björk, 47 ans, s’est constituée en référence ; son nom appartient à cette galaxie d’artistes (Thom Yorke, David Bowie) qui gravitent exactement entre les orbites du populaire et de l’expérimentation. Chacune de ses apparitions prend des dimensions prophétiques. Peut-être le parterre de Caprices n’était-il pas plein à craquer lundi soir, peut-être le public avait-il l’écoute calme de l’âge mûr plutôt que les embardées de l’adolescence, mais la simple présence de l’artiste suffit à donner un crédit particulier à cette dixième édition du festival.
Oui, l’Islandaise possède une présence de rock star, une puissance rentrée, travestie en vulnérabilité, qui captive les foules au creux de quelques vocalises suspendues. Ce qui frappe, c’est la frugalité du dispositif instrumental. Un percussionniste règne sur un monde de cloches et de marimbas. Quelques synthétiseurs et un ordinateur prêtent leur force de frappe en renfort. Mais c’est surtout l’impressionnant travail d’entrelacs du chœur, serti de paillettes couleur d’étang, qui donne sa consistance à l’ensemble, dont l’esthétique délicate et souple découle directement du dernier album studio de la chanteuse, Biophilia. Un univers porté par des visuels vidéo hautement organiques, dans lesquels les cellules font chanter leurs mitochondries, les champignons croissent comme des chorégraphies, et les lunes jouent les gyrophares.
Le plus beau, ce sont ces moments où les voix de femmes forment des nuées irradiantes (« Isobel »), ces passages dans lesquels Björk dépose son timbre nu, encore et toujours enfantin, sur des basses telluriques (« Crystalline »), ou encore la réinterprétation de quelque tube d’avant au gré de l’instrumentarium de Biophilia (« Pagan Poetry »).
Et puis il y a ces instants symboliques, pendant le hit « Joga », qui voient la vidéo originale plonger dans le corps de Björk et rejoindre une île intérieure à grand renfort d’images de synthèse, ou ces serpentins d’ADN tournoyants en trois dimensions, extraits du récent « Hollow ». Loin des robots cliniques de « All is full of love », Björk s’invente en icône post-science-fiction, réconciliant dans son avant-gardisme nature et technologie, voix et sampling, acoustique et électronique. Une manière de se rendre pointue autant qu’accessible, et peu à peu intemporelle.
source : Le Temps