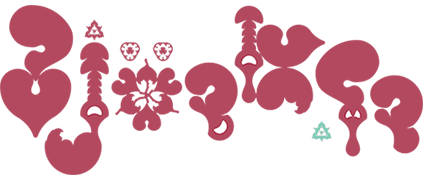Des nuées islandaises se sont abattues dimanche soir sur les quais surchauffés de Montreux. D’abord très littéralement avec une petite averse bienvenue, puis de façon plus symbolique avec le concert de Björk au Stravinski, qui succédait à celui de Nick Cave, la veille. Une invitée de choix dont la venue dans le cadre de son « Orchestral Tour », ici en compagnie du Sinfonietta de Lausanne, a été repoussée deux fois pour cause de pandémie, comme elle le confessait elle-même à la fin de sa prestation exceptionnelle à plus d’un titre.
Déjà parce qu’il est loin le temps où la chanteuse était une presque habituée de nos contrées – ses concerts au Métropole ou à Montreux dans les années 1990 n’ont été suivis que par sa venue au Paléo en 2007. Mais aussi parce que la star s’était un peu perdue dans des projets similaires, si ce n’est rébarbatifs, au cours du nouveau siècle, sans parvenir à rallumer cette flamme qui la faisait briller il y a bientôt 30 ans, avec son premier album solo, le bien nommé « Debut ».
Cinq ans après son dernier enregistrement studio, « Utopia », l’inclassable vocaliste arrivait à Montreux précédée d’un grand point d’interrogation : que pouvait-on attendre d’elle après tant d’années ? Dès son entrée sur scène, dans l’un de ces costumes dont elle a le secret, une pièce enrubannée de blanc dont surgissaient une moitié de haut verdâtre et un loup étincelant de mille feux sur le visage, tous les doutes se dissipait au premier titre, « Stonemilker ».
Prédominance de son organe
La voix de la chanteuse de bientôt 57 ans est encore capable de miracles d’expressivité et de modulations, malgré quelques rares pointes dans les aigus désormais légèrement limitées. Épaulée par les cordes aussi veloutées qu’ajustées d’un Sinfonietta dirigé par le jeune chef islandais Bjarni Frimann Bjarnason – on aura vu au moins une fois dans sa vie un chef aux bras nus ! – Björk affichait immédiatement la prédominance de son organe, central dans ce dispositif orchestral.
C’est peut-être ce défi artistique magnifiquement tenu qui captivait aussitôt. La voix très en avant, dénuée d’effets (ou si peu), emportait, même quand ses contes sinueux jouaient de la dissonance, des ruptures, des contrastes entre l’acidité de son chant et la douceur des cordes, même si, à une ou deux reprises, notamment lors d’« Hyperballad », on aurait aimé plus de puissance de la part de l’orchestre.
La comparaison a parfois été galvaudée, mais on la répétera tout de même : à son meilleur, le chant de Björk semble traversé par les forces élémentaires de l’eau, de l’air, de la terre et du feu, si présentes dans la géographie islandaise rythmée par les volcans, les glaciers, les vents et les mousses.
Beautés d’« Homogenic »
Ce n’est peut-être pas un hasard si, après une première longue séquence sans morceaux très connus de son répertoire, l’amorce d’une seconde partie plus riche se faisait avec « Hunter », de l’album « Homogenic », enregistrement caractéristique de l’homologie entre le paysage islandais et la musique de la native de l’île nordique et dont les titres reviendront plusieurs fois s’inviter dans sa performance, en concurrence avec ceux de « Post » et « Vespertine ». Et cela jusqu’à la conclusion, avec « Pluto » qui fermait la marche d’une prestation relevée avec ce défi énergique de traduire un morceau technoïde dans un vocabulaire accessible au Sinfonietta. Un nouveau concert d’anthologie pour le Montreux Jazz, qui résonnait comme des retrouvailles avec une artiste et sa légende à nouveau bien vivante.
Seul petit bémol, les avertissements initiaux pour dissuader le public de prendre des images étaient à saluer, mais l’absence d’écrans, couplée à un public qui peinait à prendre une forme compacte, a pu frustrer certains spectateurs relégués dans le fond ou sur les bords de la salle, qui auront abandonné ou se seront contentés du son, sans rien voir de la chanteuse.