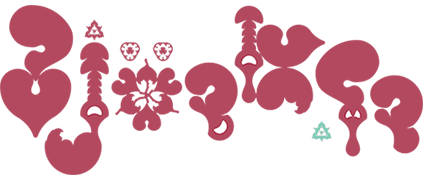Cannibale, mangeuse de sons, Björk ne connaît pas de limites à la transgression des genres. Dans son entreprise de vol organisé des beautés du monde et de ses chaos, l’Islandaise n’agit jamais seule.
Depuis le bien nommé Debut (1993), la liste des comparses de ses larcins ferait un parfait fichier des créateurs à hauts risques. De l’Anglo-Indien Talvin Singh au duo électronique américain Matmos, de Robert Wyatt aux chants inuit, tout ce peuple de faucheurs d’étiquettes, adorateur du dieu machine par ailleurs, l’a aidée dans une entreprise de sape.
Qui a-t-elle recruté pour Volta, son sixième album studio ? Des barges, des baroques, des virtuoses, des éblouissements : Antony Hegarty, chantre de la culture transsexuelle au sein d’Antony & the Johnsons, Timbaland, l’homme des succès en boucle du hip-hop et du R’n’B américains, les Congolais électro-roots Konono N°1, le joueur de kora malienToumani Diabaté, la joueuse de luth chinoise Min Xiao-fen, les ordinateurs du Britannique Mark Bell (ex-LFO)...
Cet échantillon hétéroclite et cependant uni aide Björk à bâtir un monde où la voix est reine. Il y a celle, acide, pointue, subitement cassée, de Björk, celle haute d’Anthony, et puis des milliards d’entrelacs, de répétitions, de boucles, comme c’était déjà le cas dans Medùlla (2004).
Dans Volta, chef-d’œuvre d’équilibre, Björk sème tempête et zizanie. Elle en appelle aux amours ardentes (The Dull Flame of Desire, un poème du Russe Fyodor Tuytchev chanté avec Anthony), à la révolte identitaire (Declare Independence, coup de poing électronique). Elle distille parfois un ennui aérien (Pneumonia) ou, à l’inverse, une charge militaire zombie et drolatique (Earth Intruders, avec Timbaland). Et puis il y a cette chanson, Wanderlust, remarquable travail de fond sur les voix et les sons, où l’on entend des sirènes de bateaux, oiseaux de mer, une extraordinaire fanfare islandaise et des loops électroniques : à rester bouche bée.