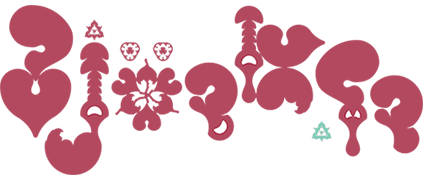En 2007, l’Islandaise Björk publiait Volta, chef-d’oeuvre de déchirement et de transgression, un album qu’elle qualifie aujourd’hui de "masculin". Biophilia, qui paraît le lundi 10 octobre, est en comparaison un océan de yin - la féminité, l’ombre, le latent dans la pensée chinoise. Le très yang Volta clamait dans la chaleur et la brillance la nécessité du combat pour l’indépendance, se servant des méandres transgenres d’Antony Hegarty, l’ami des queers, ou de la vigueur du rappeur et producteur Timbaland.
Comparé à Volta, l’ambitieux Biophilia est d’un profond ennui, ce qui n’était pas le cas non plus du sophistiqué, expérimental Medulla, entrelacs de voix humaines qui faisaient dévier la pop électronique islandaise vers des contrées sauvages et vierges, tout en souffle. Pour autant, Biophilia n’est pas mauvais. Il a de lumineuses singularités, comme Mutual Core, qui joue en s’énervant enfin avec les rythmes, l’orgue, les frottements, les effets électroniques, ou Dark Matter, composé avec Mark Bell, "sculpture sonore" de Leila Arab, velouté translucide et vibrant, posé sur une voix berçante, une splendeur. La retombée est immédiate, Bollow, le titre suivant, est d’une lourdeur déprimante. Ni les choeurs ni les talents réunis de Matthew Herbert et de Damian Taylor aux ordinateurs ne parviennent à effacer l’effet glue.
Posture
Sa nouvelle apparence - cette immense perruque orange qui noie le visage enfantin dans des fils rassemblés en masse - donne quelques indications sur la posture. Björk s’est en réalité empêtrée dans les annexes : applications pour iPad et iPhone, concepts graphiques, modes de composition, études mathématiques, pensées philosophiques, tout cela a été commenté en abondance, avant tout effort d’écoute, d’autant que cet animal bizarre donne des concerts de haute tenue. Elle a présenté la version scénique de Biophilia début juillet, au Festival de Manchester, à un auditoire médusé par huit écrans déployant des tunnels de cristaux sur Crystalline, des étals galactiques sur Cosmogony, et tous les instruments inventés (sharpsichord, gameleste, harpes pendulaires...).
De même, Björk développe un discours passionnant sur les conditions de la production de la musique enregistrée aujourd’hui. Elle a abondamment expliqué comment elle avait composé les dix titres de Biophilia (plus trois bonus, dont Nattüra, composé en 2008 pour soutenir le combat écologique en Islande, et chanté avec Tom Yorke de Radiohead) sur une tablette numérique, et comment en ce cas le tactile nourrissait le chemin musical et l’errance de la pensée.
Le sachant, l’auditeur pourra imaginer que les notes de harpe égrainées en introduction (Moon) ne l’ont pas été par la harpiste américaine Zeena Parkins, mais sont le produit de petits tapotements du doigt sur un écran tactile. Et que Björk est une petite fille perdue dans ces univers tous comptes faits extrêmement abstraits. La voici donc vocalisante, avec de petits "hou, hou, hou", sur fond de clochettes, tentant la dissonance (Uirus).
Ce qui n’était certainement pas calculé, c’est que l’abondance de données, l’ingérence de la science, de l’intellect, arrivées dans ces applications made in Apple, pouvaient faire passer le plaisir de la musique et du rythme au second plan. Placée en avant, la voix sert à convaincre. De quoi ? Du bien-fondé de la démarche, de l’urgence de la rupture. Ce qui place Björk très en avance, à l’écart.