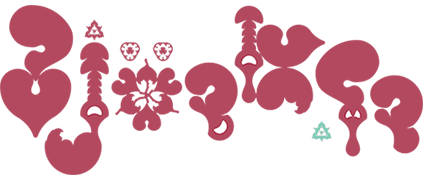L’icône islandaise a lancé jeudi à Manchester une saga live de trois ans, autour de « Biophilia », CD ésotérico-écolo attendu fin septembre.
Jeudi, en Angleterre, a débuté le Manchester International Festival. On pourrait interpréter comme un flagrant délit de snobisme le fait d’aller fureter outre-Manche, à une époque rituellement pléthorique où, de Belfort à Arras, via Hérouville-Saint-Clair ou Saint-Denis-de-Gastines, les occasions de faire le plein de décibels abondent dans l’Hexagone. Sauf que le MIF n’est pas une manifestation ordinaire qui, jusqu’au 17 juillet, annonce : Dr Dee, le nouvel opéra de Damon Albarn, le boom rock local WU Lyf, la chanteuse gospel américaine Candi Staton, The Life and Death of Marina Abramovic, une mise en scène de Bob Wilson, le rappeur américain Snoop Dogg, une Walkyrie de Wagner et, puisqu’on en est aux figures de la mythologie nordique : Björk.
Fumerolles. Dans la ville de Wayne Rooney, donc, la chanteuse islandaise la plus connue du millénaire est revenue sur scène de manière tonitruante, y présentant son projet Biophilia, entreprise tentaculaire aux ramifications musico-technologico-environnementalo-esotérico-pédagogiques, entre autres. Une approche que la pythie des fumerolles introduit ainsi : « Si j’envisage Biophilia à une si grande échelle, c’est que je suis bien incapable d’expliquer les sons et les rythmes sans me référer au système solaire et aux atomes. Pour moi, tout cela appartient au même univers. »
Pour commencer mollo, on dira que, dans sa forme la plus conventionnelle, Biophilia sera le prochain album de Björk ; avec dix chansons, dont Crystalline, single fraîchement éclos, sa commercialisation est prévue le 26 septembre.
Ceci posé, un bouquet de dix applications (une par titre) « associant un élément naturel à un aspect musical », avec jeu interactif, score animé, paroles, etc., va être mis en circulation, ainsi qu’un documentaire (en cours), le site de la chanteuse (www.bjork.com) profitant de l’occasion pour continuer sa mue high-tech. Mais, pour l’heure, c’est face au public que Björk a choisi de donner la pleine démesure de son inspiration échevelée, à travers le lancement d’une tournée mondiale prévue sur trois ans avec des résidences de trois semaines dans huit villes différentes - a priori, Paris est prévu pour 2012, dans un lieu encore à définir. Autant dire que la mise à feu mancunienne suscite une excitation particulière ; au point que, devant le Campfield Market Hall dûment pris d’assaut- 45 euros la place, tarif fort raisonnable pour une visitation -, on croise dans l’assistance des gens tels que l’acteur Willem Dafoe ou le chanteur Antony Hegarty (patron des Johnsons) entre autres disciples ponctuels.
Dans la salle, le dispositif est particulier, avec une scène centrale circulaire - surmontée de huit panneaux faisant office d’écrans -, autour de laquelle se tiennent 1 800 spectateurs debout. Aucun décor n’est nécessaire, dans la mesure où Björk et sa clique (un inventeur anglais, un fabricant d’orgues islandais, un laboratoire media du MIT) ont conçu une instrumentation quasi féerique : harpes-pendules hautes de trois mètres, boîte à musique-célesta géante baptisée « Sharpsichord », arcs électriques ou orgue d’église bidouillé en claviers midi - que le public, comme au musée, ira prendre en photo à la fin de la représentation.
Sur scène, la chamane, coiffée d’une invraisemblable perruque afro rousse, vêtue d’une robe courte et d’une cape bleue, est entourée (le mot est faible, tant l’accompagnement confinera parfois à la suffocation) de deux musiciens, Matt Robertson (aux machines) et Manu Delago (batterie, percussions), et surtout d’un chœur féminin constitué de 23 compatriotes, qui l’enveloppe, la couve, l’encercle. Tout en « whou-ou-ou » et « na na na », la volière nubile strie la vingtaine de titres du répertoire de ses élans polyphoniques aussi spectaculaires qu’à la longue mirifiquement tyrannique.
Cyberfolk. Mi-« Seigneurie des agnelles » (une voix off de birbe donne le ton en introït, limite heroic fantasy : « Bienvenue dans Biophilia… »), mi-« Tubular belles », on suit l’odyssée de deux heures dans une ambiance Zardoz reformatée Avatar, avec en bande-son une cosmogonie pop mêlant cyberfolk et techno imprécatoire. Equitablement réparti entre nouveautés (Thunderbolt, Moon, Hollow, Virus…) et « classiques » (Hidden Place, Isobel, Declare Independence…), le show rétrofuturiste - où plane l’ombre de Nikola Tesla comme celle du vendeur de la boutique Apple du coin - joint l’image (galaxie, éruption volcanique, lucioles, étoiles de mer, flore fantasmagorique…) à la parole.
Blanche Neige numérique, Björk chante les champignons et le quartz, les renards argentés et le tonnerre avec une conviction qui, à l’inverse de sa performance, laisse sans voix.