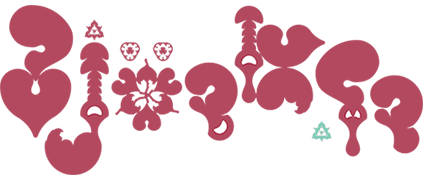C’est une période très excitante de ma vie : tous ces gens qui veulent me rencontrer, ce disque dont j’assume chaque note, chaque chanson. J’ai toujours été habituée à partager, à ne jamais tirer la couverture à moi, ayant grandi dans une communauté hippie où les adultes me traitaient comme leur égale et m’incitaient à offrir autant qu’à recevoir. Mes parents me laissaient très libre, se contentant de me donner des leçons d’amour, de fraternité. J’ai toujours baigné dans cet esprit d’échange, de complémentarité. Mais aujourd’hui, l’esprit communautaire s’évanouit. Je m’occupe enfin de moi.
Dans quel état d’esprit as-tu effectué ce grand saut, de chanteuse de groupe en artiste solo ?
Tout cela a été très naturel, sans sursaut. J’étais préparée, mon expérience dans le monde de la musique ne pouvait être meilleure... En fait, j’ai commencé à m’intéresser au rock vers 16 ans, en Islande. Des copains venaient de former un label indépendant, le premier du pays, l’unique petite organisation osant défier Madonna et Michael Jackson. En Islande, pour vivre de sa musique, il fallait être terriblement commercial. Il n’existait pas d’autre solution, pas de groupes de rock. Tous ceux qui tentaient l’aventure raccrochaient au bout de six mois, après avoir vendu leur maison pour financer leur disque. Notre label publiait des disques de jazz, de world-music, de punk, tout ce que la bonne société islandaise refusait de commercialiser. C’était une vraie bataille, il fallait trouver des magouilles pour survivre, sans cesse inventer des idées. Bien sûr, personne n’était payé, il fallait avoir un petit job en parallèle. Si bien que chaque moment passé au label revêtait une importance spéciale, très précieuse. Nous devions coller les affiches nous-mêmes, faire le ménage, nettoyer le parquet, nous occuper de la comptabilité. Ce fut une excellente école, un apprentissage du business au niveau d’un minuscule pays, presque un village... Soudain, quelques années plus tard, l’Angleterre a découvert les Sugarcubes. D’un seul coup, nous nous sommes retrouvés à négocier avec de grosses maisons de disques, des directeurs du marketing, des directeurs promo. Mais nous étions affûtés. Ces gens-là étaient souvent des bandits, mais nous comprenions leur langage.
T’es-tu sentie toi-même blessée ?
Au départ, oui. II a fallu se battre. Nous débarquions tout de même d’Islande avec les yeux grands ouverts, pleins d’espoir. Très vite, on nous a fait une réputation de coriaces et durs en affaires, parce que nous savions ce que nous voulions. Habituellement, les grandes compagnies réfléchissent pour leurs artistes, elles n’ont pas l’habitude de voir arriver sept ou huit hurluberlus islandais prêts à leur tenir tête. Je suis toujours comme ça aujourd’hui : on ne me marche pas sur les pieds.
En arrivant en Angleterre avec les Sugarcubes, envisageais-tu déjà une possible carrière solo ?
J’y pensais depuis des années, mais je me sentais bloquée par ce déséquilibre entre art et commerce. Être chanteuse ne signifie pas chanter, malheureusement, mais implique énormément d’autres choses, un paquet d’âneries qui me terrifiaient à un niveau intime. Je n’étais pas prête pour le grand saut, j’avais la frousse.
Comment expliques-tu cette peur ? Je t’ai toujours trouvée plutôt volontaire, un peu tête brûlée.
Je ne pouvais pas passer de l’amitié la plus forte, celle des Sugarcubes, à l’égoïsme le plus effronté, celui du disque solo. Je n’ai pas été habituée à manger mon gâteau dans mon coin, sans partager. J’ai toujours vécu en bande, grandi et voyagé en communauté. Passer du jour au lendemain de l’amour des autres à l’amour de soi me semblait impossible. L’acte solo est terriblement égoïste : il faut se forcer à n’entendre que soi, ne pas écouter les doléances des autres. Choisir ses instruments, sa pochette, ses fringues toute seule. Devenir adulte, en somme. J’ai mis beaucoup de temps à l’accepter. Pendant très longtemps, je n’ai souhaité qu’une chose : assouvir les rêves des autres, mettre ma voix et mon esprit au service de mes amis, chanter et vivre pour eux. Mais cette page est tournée. Maintenant, c’est mon tour. C’est ma fête.
Qu’as-tu appris depuis que tu vis à Londres ?
A un niveau intime, la vie n’est pas désagréable. Je dévore tout ce qui n’est pas disponible en Islande : cinéma underground, disquaires indépendants, galeries d’art. Mais mon pays me manque. Surtout mon village, où je connais tout le monde, où je peux marcher pieds nus dans la rue. Je peux parler à qui je veux, connaître leur vie, leurs problèmes, partager leurs joies. Mon village est un nid. J’y ai mes habitudes, je sais où acheter le meilleur poisson, les meilleures chaussettes. Tout est sûr, acquis. Je n’ai pas besoin de me battre. Ici, c’est une autre histoire. Mais je l’ai voulue, cette vie. Je veux la vivre à fond.
Des événements particuliers ont-ils provoqué ton départ du groupe ?
Rien de très précis, juste une frustration grandissante au niveau musical. Je n’ai jamais été satisfaite par la musique des Sugarcubes. Mais je me taisais, je ne voulais pas gâcher la fête. J’ai toujours considéré que dans un groupe, les individus devaient se faire discrets, laisser leur orgueil au vestiaire et se mettre au service de la musique. Je ne pouvais pas m’imaginer arrivant à une répétition et lançant à la cantonade : "Votre musique m’ennuie, essayez plutôt cette chanson que je viens d’écrire, elle est géniale." Les Sugarcubes était une petite société très équitable, très juste où chacun apportait sa contribution sans bouleverser l’équilibre. Pas de problème d’ego, pas de lutte, pas de concours de bras de fer.
Ne regrettes-tu pas d’être restée sagement à ta place ? Un peu de tension aurait peut-être profité aux chansons.
Au départ, notre équilibre était idéal et les chansons s’en ressentaient : Birthday par exemple, une vraie chanson de joie collective. Mais peu à peu, chacun s’est habitué à sa petite place, comme lorsqu’on dort à deux dans un lit, on trouve ses repères. Le groupe s’est un peu endormi. Il n’y avait plus de surprises. Nous nous sommes laissés couler comme un vieux couple. Les premiers mois, on se surprend : petit déjeuner au lit, des tas de cadeaux, dîner en pleine nuit. Et puis le temps passe... La spontanéité laisse sa place aux compromis, aux arrangements silencieux.
N’est-ce pas fatal ?
Je rêve que non. Heureusement, les Sugarcubes n’étaient pas une occupation à plein temps. Le groupe n’était qu’une des branches de notre arbre. Notre petite compagnie, Bad Taste, organisait des expositions, des projections de films, publiait des livres, des disques. Finalement, les Sugarcubes n’existaient qu’à l’étranger, en tournée ou lorsqu’il fallait enregistrer. Le reste du temps, la vie normale reprenait. Avec ses surprises. Voilà comment le groupe a tenu : parce que nous n’étions pas toujours les Sugarcubes.
Le plus dur, ce fut de laisser mes copains en Islande. Je les connais tous depuis dix ans, ce sont mes meilleurs amis. Mais ils me comprennent. Cette carrière solo, je ne pouvais pas l’entreprendre depuis l’Islande, un vrai suicide commercial. D’ailleurs, en 87, les Sugarcubes avaient refusé de venir s’installer en Angleterre... Cette fois, j’ai choisi de partir vivre à Londres. à deux heures d’avion de chez moi. J’ai pris mon petit garçon de 7 ans sous le bras et nous sommes partis en quête d’une maison. Je savais que j’allais me sentir comme une étrangère, mais je n’avais pas le choix. J’ai organisé une petite réunion au bureau pour prévenir tout le monde. J’étais partagée entre la peine et la détermination. Il fallait bouger, tuer la routine, faire autre chose. Certains membres du groupe ont été très peinés, comme Bragi, le bassiste. Parce qu’il appartenait au clan Sugarcubes, il n’avait pas le temps de se consacrer à son propre travail, ses livres, ses poèmes. Lorsque la fête s’est achevée, il s’est senti un peu trahi. Les autres ont mieux encaissé le choc. Simplement parce que les Sugarcubes n’ont jamais été l’élément le plus important de notre vie. Notre vie intime passait avant, le travail, l’amour, le couple, la famille. A un moment, le hobby Sugarcubes est devenu très obsédant, accaparant tout notre temps, mais nous avons su réagir, prendre du repos, des congés pour veiller sur nos enfants, très nombreux dans la famille Sugarcubes. Si bien que nous arrivions toujours à rétablir l’équilibre dans nos vies. Si tu manges trop de chocolat le lundi, tu vas faire du sport le mardi.
Ne regrettes-tu pas ce détachement vis-à-vis du groupe, cette sagesse ?
Aujourd’hui, c’est un autre milieu, plus prenant, mais passionnant. Beaucoup plus sérieux. Les gens ne comprennent pas que les Sugarcubes ont toujours été une blague. Ils nous jugent selon les critères habituels du monde du rock, crédibilité, ventes de disques, concerts, sans comprendre que nous étions seulement là pour nous amuser. Nous en avons déconcertés beaucoup, c’était si drôle. Nous étions là pour rire, visiter le monde, apprendre. J’ai vu tous les pays de mes rêves, je sais mille fois plus de choses qu’en sortant de l’école, j’ai rencontré des gens fantastiques, jeunes, vieux, beaux, moches ; j’ai visité des églises, des clubs, des musées. Et surtout, j’ai des amis dans tous les pays.
Cette soif de savoir était-elle attisée par tes origines ?
Rien n’est disponible en Islande. La culture mondiale doit se perdre en route. Alors, il faut bouger, prendre le bateau, très jeune, et aller voir ailleurs. Les Sugarcubes sont pour nous un moyen de voyager, de nous évader de notre petite terre sèche.
Tu sembles en parler comme d’un groupe encore en vie.
Les Sugarcubes existent. Mais en ce moment, ils dorment (sourire)... Nous n’avons jamais réfléchi en termes de carrière. Je ne sais pas ce qui peut se passer maintenant. Tout est possible. En tout cas, je meurs d’envie d’enregistrer un deuxième album très vite. J’ai des dizaines de chansons qui attendent. J’en écris depuis que je suis toute petite, certaines ont plus de vingt ans.
La chanson Human behaviour, premier titre de l’album et 45t, a été composée en 88. Pourquoi ne pas l’avoir proposée aux Sugarcubes ?
Le groupe et mes chansons étaient deux choses bien distinctes. Je leur donnais déjà ma voix, mon temps, mon énergie, des idées. Je ne souhaitais pas donner plus. Ces chansons me sont trop chères. Les donner en pâture au groupe m’aurait été insupportable. Nous avions tous notre jardin secret.
En prenant tes distances il y a maintenant un an, étais-tu certaine d’être à la hauteur de tes ambitions ?
J’avais déjà enregistré quelques disques solo, des albums totalement inconnus en France et en Angleterre mais qui ont eu un gros succès en Islande. Le plus récent, Gling glo, des chansons islandaises des années 50, est platine dans mon pays. J’ai enregistré mon premier disque à 11 ans, des chansons d’enfant. Le titre de mon nouvel album, Debut, est donc plutôt ironique (sourire)... Le grand changement avec Debut, c’est que cette fois, je vise le monde, pas seulement ma province. C’est un autre business. Il faut apprendre à être dure, égoïste, à se faire plaisir avant de faire plaisir aux autres. Mais satisfaire les autres ne m’a jamais posé de problème, j’aime ça. Comme lorsqu’on invite des amis, qu’on s’affaire en cuisine. Il y a un vrai plaisir à servir les autres, à cuisiner pour eux, à leur servir de la bière fraîche. Seulement, cette fois, je veux tirer un plaisir immédiat, direct, de ce que j’entreprends.
Sexuellement, on pourrait dire que je pense à ma jouissance avant de penser à satisfaire mon partenaire. C’est presque un plaisir malsain, une vengeance. Pas de manière consciente. J’ai plutôt le sentiment d’un changement naturel, une évolution inévitable après toutes ces années de bon service. Maintenant, les invités sont partis. Je monte dans ma chambre et je m’enferme de l’intérieur. Je ne souhaite de mal à personne. Je veux juste me faire du bien (sourire)... Dans ma chambre, je peux utiliser tous les mots que j’aime, les petits sons que j’aime, toutes ces idées que je gardais pour moi auparavant. C’est magique, c’est un moment merveilleux de se retrouver seule et d’enregistrer le disque dont on rêve.
Musicalement, comment se sont effectués tes premiers choix d’artiste solo ?
Certaines chansons avaient déjà deux ou trois ans. Lorsque le projet s’est concrétisé, après notre tournée américaine en première partie de U2, et qu’il a fallu songer à enregistrer, je ne me suis posé aucune question. Je voulais aller vite, travailler tout de suite. Les rythmes et les instruments sont venus d’eux-mêmes, naturellement. Moi, je me tenais en retrait, laissant la musique couler. Si un morceau réclamait un beat techno, alors je lui donnais un rythme techno. S’il fallait neuf violons pour le morceau suivant, cela ne posait aucun problème. C’est un disque très spontané. Je ne me suis jamais sentie aussi libre. Vocalement, c’est exactement la même chose. Je ne me suis jamais considérée comme une chanteuse, pas plus aujourd’hui qu’au sein des Sugarcubes. Je possède une jolie voix, que j’offre à la chanson. J’ai toujours pensé que ma voix devait se perdre dans la musique, qu’en devenant invisible, incrustée dans la matière, elle n’en ressortirait que mieux. C’est un peu comme pour le sexe. Lorsqu’on se laisse vraiment aller, lorsqu’on fait corps avec l’autre, la vérité sort d’elle-même.
Le choix de Nellee Hooper de Soul II Soul à la production s’est-il imposé de lui-même ?
J’aime Soul II Soul, les chansons de Nellee, leur esprit, mais tout cela a déjà été fait. Moi, je voulais du neuf, pas un croisement entre Soul II Soul et les Sugarcubes. Lui aussi était prêt à faire une croix sur ses connaissances, son passé de musicien. Il était disposé à prendre beaucoup de risques avec moi. Nous sommes allés très vite, sans trop réfléchir, une chanson par jour, enregistrement, chant et mixage inclus. J’ai joué tous les instruments, Nellee s’occupait des rythmes et des sons. Je trouve très étrange qu’il n’y ait jamais de disque comme celui-ci disponible. Sinon, je l’aurais acheté. Je continue à chercher le disque de mes rêves dans les magasins, un disque relax et gai, vivant. Comme je ne le trouvais pas, je l’ai fait moi-même (sourire)...
Tu sembles t’être imprégnée de dance culture pour cet album, y mêlant des rythmes assez radicaux avec d’autres influences dont le jazz. Qui t’a dirigée dans ce parcours initiatique ? Qui ta fait découvrir les clubs ?
Des gens du monde entier. Lorsque nous partions en tournée avec le groupe, je refusais d’aller me coucher après le concert. J’étais toujours la dernière debout, à danser dans les clubs de la ville, New York, Londres, Manchester, Paris, Rome. Je trouvais ça plus passionnant que les concerts, tellement ennuyeux. J’avais mes habitudes, mes clubs et mes DJ’s préférés. En Angleterre, les gens de 808 State m’emmenaient dans les raves, j’adorais ça. J’ai toujours aimé le rythme. Tout ce que j’écoute, jazz avant-garde, house-music, a ceci en commun : le rythme prédominant. Mais étrangement, les morceaux de Debut étaient dépourvus de rythme, ce n’était que des mélodies, des boucles vocales. Nellee a dû habiller l’ensemble.
Le résultat est surprenant.
J’avais peur de ne pas être comprise. Ça n’est pas un disque facile, il est très personnel. J’aurais tout aussi bien pu publier mon journal intime. Maintenant, je dois accepter que les gens pénètrent mes petits secrets. Je dois passer de l’introspection du disque à l’ouverture d’esprit que demande la promotion. Je me sens comme ces gens qui sortent d’une cave après trois jours et se retrouvent en plein soleil... Ma sincérité doit toucher l’auditeur. Je n’ai pas menti, tout est dans mon disque, exactement celui dont je rêvais.
Les textes des Sugarcubes n’étaient pas très intimistes.
Nous chantions la fête, l’alcool, la musique. Debut n’est pas comme ça. C’est un disque sur l’homme, sur l’amour. Un disque très impudique. Mais je me fiche de savoir si les gens vont analyser mes textes. Ils se tromperont sans doute, cela importe peu.
Les Sugarcubes ne sortent pas grandis de la comparaison entre leurs derniers disques et le tien.
(Rires)... Je trouve cela un peu triste pour le groupe, qui ne mérite pas ce genre de constat. Nous étions comme un groupe de bal, donc à juger comme tel. Nous ne comprenions jamais pourquoi des centaines de journalistes tentaient d’analyser notre musique, cela nous faisait beaucoup rire... Les autres membres des Sugarcubes se moquent de ce genre de comparaisons. Ils ont d’autres richesses dans leur vie. Siggi, le batteur, chante par exemple pour le groupe le plus populaire d’Islande, c’est une vraie star... Après notre dernier album, beaucoup de gens nous demandaient si nous étions déçus par les critiques sévères dans la presse. Mais nous nous en fichions. La plupart du temps, nous ne pouvions même pas lire les journaux. L’isolement de notre pays a parfois du bon (sourire)... C’est un pays perdu, rien ne l’affecte. Les derniers à avoir voulu envahir l’Islande sont les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler voulait y installer une forte communauté aryenne, une sorte de réservoir ethnique où la race pure n’aurait pas été menacée. Il disait que c’était la terre la plus pure au monde, ce qui est sans doute vrai si l’on suit son raisonnement de sale fasciste. En Islande, il doit y avoir trois personnes noires. Alors bien sûr, les gens disent qu’ils ne sont pas racistes. Ils ne savent pas ce que c’est, le racisme. Ils n’y sont pas confrontés. L’île est encore protégée contre ce type de mal social, mais pour combien de temps ? Ma mère s’est fait virer de son boulot la semaine dernière. La récession arrive. Les vieux disent qu’il y a moins de poissons dans l’océan. Et sans poissons...
Björk
Debut
One Little Indian/Barclay
Il y eut une époque où la musique des Sugarcubes faisait figure de remontant. Fraîche et tarabiscotée, portée par la voix sauvageonne de Björk, cette inédite solution pop associait menthol et grains de poivre, dégageait les bronches et arrachait la gorge, aérait l’esprit. Temps bénis et éphémères. C’était il y a cinq ans, autant dire une éternité pour les Sugarcubes, vite engagés dans l’impasse. Le bel éclat de Life’s too good, le vilain bourbier de Here today, tomorrow next week, le clair-obscur de Stick around for joy : trois albums pour former la trilogie thèse-antithèse-synthèse d’un parcours aussi carré et implacable qu’une disserte à Sciences po, avant la conclusion, sous forme d’implosion. Pas découragée par le naufrage, Björk a remis vite fait son cœur à l’ouvrage. On la croyait petit brin de femme, on l’avait découverte meneuse de troupe, on la retrouve seule maîtresse à bord, pilotant un album complexe et décomplexé. Björk confirme qu’elle a du caractère et, de toute évidence, une sainte horreur pour les chemins trop bien tracés, comme ce registre jazzy mollasse où elle était annoncée, où on la voyait déjà s’engluer. Avec une détermination qui sent la frustration longtemps accumulée, elle a préféré mener de front deux combats. L’un, première surprise, l’entraîne sur les terrains surpeuplés de la dance où, bien épaulée par Nellee Hooper (Soul II Soul), Björk fait d’entrée le vide autour d’elle, se crée un espace, pose le ton. A partir d’une base posément techno, sa voix donne corps à d’étonnantes équations aux multiples inconnues. Pour preuve l’inquiétant One day, ce There’s more to life than this gai luron, ou encore ce sommet qu’est Come to me, ballade enjoleuse et égarée, entre griseries d’altitude et rêves sous-marins. L’autre versant de cet album, deuxième surprise, l’amène à tourner encore davantage le dos aux coutumes et au confort rock, à coups d’arrangements singuliers, de broderies bizarrement ourlées. Like someone in love se fond ainsi dans les volutes d’une harpe volatile. The Anchor song se réfugie dans les rondeurs à la fois chaleureuses et chagrines d’un chœur tempéré de cuivres. Que se forment ainsi des couples aussi imprévus qu’électronique/chair de poule ou saxophones/sobriété montre combien ce disque a des allures de petit miracle. Une manière de dompter l’impossible, d’apprivoiser l’improbable, qui explique pourquoi ce projet ambitieux, virage dangereux sur le parcours déjà accidenté de Björk, a pu la mener vers un disque aux courbes aussi charmeuses.
Richard Robert