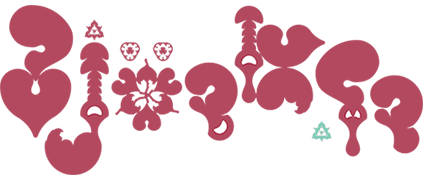« C’était génial. » Los Angeles se réveille avec la migraine d’une nuit de terreur, mais Björk est radieuse. « Je me suis réveillée en sursaut deux minutes avant le début du tremblement de terre. Je savais que quelque chose allait se passer. Je me suis assise en lotus sur mon lit et je n’en ai pas perdu une miette. Toute ma vie, j’avais attendu ce moment ! J’ai raconté ça à un chauffeur de taxi ce matin, il ma proposé un boulot de vigie à l’institut de sismologie de Los Angeles. » La veille, fraîchement débarquée de Thaïlande via Londres et en attendant de partir deux jours plus tard pour l’Australie puis le Japon, elle nous expliquait sa manière d’échapper aux décalages horaires : se saouler. Cette année, Björk a dû beaucoup boire : tournées, promotion, elle est montée au front comme peu pour défendre bec et ongles Début, son album d’orgueil. Elle tourne aujourd’hui pour récolter les prix de ses efforts, collectionnant disques d’or et titres de meilleur ouvrier de l’année. La terre a tremblé depuis 4 h du matin, mais rien ne semble troubler Björk : le succès de son album, débarrassé des dilettantes Sugarcubes, lui a apporté la sérénité - une quiétude perturbante pour qui ne veut vivre que sur la brèche, fuyant confort et facilité comme d’autres la Californie sinistrée. A l’heure des récompenses, mais aussi des angoisses métaphysiques et de la certitude d’un proche retour de bâton, rencontre singulière dans un jardin paradisiaque d’Hollywood, quelques heures avant le réveil de la terre. « A chaque fois que je viens ici, il se passe quelque chose. La dernière fois, c’était les émeutes. Les Black Crowes ont dormi dans le même hôtel que moi, ils m’ont demandé de les prévenir la prochaine fois que je serai en ville, pour éviter d y être aussi. »
Je n’arrive pas à croire ce qui m’arrive, tous ces titres de "meilleur album de l’année’... Pendant que je l’enregistrais, j’étais certaine que je n’intéresserais personne. Pour moi, c’était une régression, un retour en arrière après toutes ces années passées au sein de différents groupes, comme Kukl ou les Sugarcubes. Là, je suis redevenue égoïste pour la première fois depuis des lustres, je n’en ai fait qu’à ma tête. J’étais certaine de ne toucher qu’un faible pourcentage des fans des Sugarcubes, peut-être 10 % d’entre eux... Pour moi, Debut était beaucoup trop privé pour plaire à qui que ce soit. Et puis, au fur et à mesure que nous avons commencé à envoyer les premières cassettes de l’album, les réactions ont été très troublantes. Tout le monde adorait, les raisons de disques se battaient pour me signer. On a commencé à me dire « Tu verras, ton disque va se vendre à des centaines de milliers d’exemplaires, il sera le préféré de la critique pour l’année 93... » Toutes choses qui, depuis, se sont vérifiées. Ces réactions encourageantes m’ont beaucoup perturbée, j’étais perdue. Je n’ai toujours pas atterri, cette année a été irréelle, complètement folle. Je n’étais pas prête pour ça.
Tu as enregistré cet album seule et sans compromis. Son succès, aussi bien critique que commercial, doit être rassurant.
Je suis fière de ce disque, mais pas pour les raisons qu’invoquent les gens. Graver mon nom dans l’histoire de la pop-music, je m’en contrefiche. Tout ce qui m’intéresse dans ces prix de "meilleur disque de l’année, c’est la liberté qu’ils vont m’apporter. Pour mon deuxième album, rien ne pourra me freiner, pas plus les gens que les moyens. Pour Debut, le budget n’était pas suffisant. J’ai dû mentir, aller voir les Maisons de disques en leur jurant que ce serait le meilleur album depuis des années, une révolution... J’ai dû débiter les conneries habituelles de la pop-music, me faire passer pour Superwoman pour financer ce disque. Ce business t’oblige à adopter ces comportements ridicules. Mais là, je n’ai plus à jouer ce jeu, l’argent viendra tout seul.
Avais-tu entamé cette carrière solo, loin des Sugarcubes, pour contenter son ego ?
En Islande, j’ai grandi dans une toute petite communauté, loin du monde. Mes seuls héros étaient des scientifiques, des vulcanologues, des botanistes. Les pop-stars ne m’intéressaient pas, mon affection se portait plutôt sur des gens de l’ombre. Adolescente, c’est même devenu une règle de conduite : célébrité rimait obligatoirement avec médiocrité. La gloire ne m’a donc jamais attirée. Les Sugarcubes jouaient dans le monde entier afin de promouvoir leurs disques. Moi, j’acceptais de les suivre pour leur faire plaisir. Mais je préfère travailler en privé et vendre suffisamment de disques pour payer les factures. Ça suffit à mon bonheur. J’aime la solitude, rester dans mon coin. En même temps, vendre tant de disques est finalement un grand honneur. Cette relation de haine et d’amour avec le succès me perturbe énormément.
Qu’est-ce qui a provoqué ce désir de ce que tu appelles "l’égoïsme" ?
Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours écrit des chansons. Mais je n’avais jamais envisagé de les enregistrer un jour en solo. C’était une passion privée, une façon de rester saine d’esprit (silence)... Mon idée, ça a toujours été de travailler avec les autres, d’échanger les idées. Pour quelqu’un comme moi, qui a une telle foi dans la pop-music, qui ne vit que pour ça, ça devenait intolérable de ne pas trouver de disques à acheter dans les magasins. Je ne voyais pas au nom de quoi on ne pouvait plus produire de pop-music de qualité. Je me suis dit "Si tu ne montes pas au créneau, personne ne le fera pour toi." J’approchais de la trentaine, j’ai décidé que j’avais jusque-là choisi la facilité. Je possède une maison en Islande, j’ai beaucoup d’amis, un fils... Une parfaite petite vie de ménagère, mais sans le moindre risque. Si je voulais voyager un peu, il suffisait de monter une tournée mondiale des Sugarcubes. Je devenais lâche, je ne faisais plus le moindre effort. Quand je lisais les biographies de certains scientifiques, j’avais honte de mener une existence aussi pleutre. Je me rendais compte que tous, un jour ou l’autre, avaient eu le courage de vivre intensément leur passion, avec la prise de risques que cela implique. Au bout d’un moment, je ne pouvais plus lire des choses magnifiques, écouter des disques bouleversants, manger des plats sublimes tout en restant confortablement assise sur mon canapé. Il me fallait à mon tour faire des sacrifices.
A quelle occasion as-tu décidé de quitter ce confort ?
Il n’y a pas eu de révélation brutale, mais une longue prise de conscience. Je fais de la musique depuis que j’ai 11 ans. Je crois sincèrement que depuis ce jour, je me préparais secrètement à cette carrière solo. Travailler avec les Sugarcubes n’était qu’un apprentissage. J’observais la marche des médias, le fonctionnement des maisons de disques, je n’en perdais pas une miette. Aucun des albums des Sugarcubes ne me satisfaisait. Au fond de moi, j’étais très en colère. Les Sugarcubes ne se donnaient jamais à fond, car la musique n’était pas la chose la plus importante dans leur vie. Ils étaient poètes, écrivains, ils pensaient s’en tirer à bon compte en ne faisant que le minimum. A 18 ans, c’est une attitude compréhensible. Mais à 30 ans, c’est insupportable. Je tiens beaucoup trop à la musique pour la négliger à ce point.
Cette paresse doit être jouissive. Comment trouver suffisamment de discipline pour la vaincre ?
L’enregistrement du disque et l’année 93 se sont déroulés sans le moindre effort. La seule difficulté est mentale : me convaincre que j’ai le droit à l’égoïsme. Dire à dix personnes "Suivez mes ordres." De quel droit est-ce que j’agis ainsi, pourquoi ai-je raison ? Il faut du toupet pour donner des ordres à des avocats, à des arrangeurs... C’est dur pour une fille qui, comme moi, est le bébé du punk. Cette philosophie est la mienne : anarchie, chacun fait ce qui lui plaît, personne ne peut te donner des ordres... J’ai toujours travaillé dans des groupes démocratiques, où chaque voix comptait. Mais il faut que je m’habitue au fait que c’est ma musique et que je la connais mieux que tout le monde. C’est comme mon fils : je sais mieux que quiconque ce qu’il doit porter, dans quelle école il doit aller... Ce n’est pas du génie, juste de l’instinct.
Tu ne doutes jamais ?
Depuis le premier jour, j’ai décidé que je faisais ce disque pour moi. Chaque petit détail de cet album devait me plaire, ou je recommençais. Je suis vraiment allée au bout de chaque idée, sans la moindre barrière. Car je savais où j’allais. Mais en le réécoutant, je me rends compte que j’ai parfois été paresseuse, que j’ai joué la sécurité : couplet, refrain, couplet... Je prendrai plus de risques sur le nouveau. Je veux aller plus loin, tout en restant dans un cadre. Même le shantra bouddhiste ou le chant d’un oiseau se limitent à un cadre. Pourtant, il est des barrières que je voudrais franchir. Je veux m’approcher d’une pop-music à la fois expérimentale et parfaitement accessible. L’attitude de Stockhausen et les refrains de Boney M (rires)... Des compositeurs comme Stockhausen, Schoenberg, Messiaen ou Debussy ont énormément en commun avec la pop-music - la spontanéité ou le refus de la tradition. La pop-music devrait être ainsi, ça m’énerve de la voir se limiter à un solo de guitare ou à un son de boîte à rythmes. Comme le jazz, la pop est devenue une formule, une musique figée. Où sont passées l’ouverture d’esprit, l’aventure ? On va aujourd’hui à l’école pour étudier le jazz ou le rock comme s’il s’agissait de langues mortes. Pourtant, beaucoup de musiciens pop sont fans de ces compositeurs. Lennon, par exemple, était un grand fan de Stockhausen.
Pourquoi, alors, ce grand décalage entre ce que les gens écoutent et ce qu’ils jouent ?
C’est ce qui me perturbait le plus avec les Sugarcubes. Je suis restée avec eux car ils étaient mes amis. Mais musicalement, ils refusaient les remises en question. J’avais fini par croire que j’avais un problème : un jour, j’adorais Public Enemy et je n’écoutais que ça pendant six mois. Mais après, je passais à autre chose. Je me pensais volage, instable. Alors qu’en réalité, je n’étais que curieuse, ce dont les autres n’étaient plus capables. Leur curiosité, leur courage, le goût du risque, ils les gardaient pour leurs livres. J’étais la seule du groupe à être vraiment passionnée de musique. Chez moi, c’est une maladie : le monde peut s’écrouler, il me suffit d’un seul disque pour me remonter le moral. Mon père, lui, joue aux échecs... Mais là, petit à petit, il s’est creusé un grand fossé entre ce que j’aimais et les disques que nous sortions. Il m’a
fallu choisir entre mes aspirations et mes amis. Un choix très cruel. En fermant la porte à mes rêves, je serais devenue une mort-vivante.
Y-il une part de jeu dans cette nouvelle capacité à décider de tout ?
Avec les Sugarcubes, nous avons très vite compris que tout ça n’était qu’une vaste plaisanterie. Ces vingt ou trente dernières années, la position du musicien a pris une importance ridicule. Les chanteurs sont devenus des leaders d’opinion, même s’ils n’ont rien à offrir. A côté de ça, on méprise les sculpteurs, les chercheurs... C’est aux chanteurs de rock qu’on demande les solutions aux problèmes de ce monde, pas aux scientifiques. Quelle farce ! Il y a cent ans, les
musiciens étaient considérés comme la lie de la société, comme des romanichels.
Ne te sens-tu pas comme une usurpatrice dans ta position ?
Je n’ai jamais recherché la respectabilité. Mais je ne me sens pas très à l’aise lorsque je constate que 90% de mon temps est consacré aux médias et seulement 10 % à ma musique. Je ne suis pas ici pour m’improviser porte-parole d’une génération. Je n’y peux malheureusement rien : c’est un problème lié aux aux sociétés occidentales, dû au manque de respectabilité des politiciens. On a les leaders d’opinion qu’on peut s’offrir. J’ai juste la chance d’avoir le bon âge, le bon sexe, les bonnes opinions politiques... Mais va dans l’hôpital qui est là, en face, trouve une infirmière un peu sexy et je suis sûr qu’elle fera aussi bien l’affaire que moi.
Tu as récemment été invitée sur une radio de L.A. pour discuter avec les auditeurs de leurs problèmes de coeur ou de sexe. D’une certaine façon, tu joues le jeu de leader d’opinion.
Ce fut une expérience traumatisante. J’étais partie avec l’intention de bien rigoler avec les histoires à l’eau de rose des auditrices. "Björk, mon petit copain ne m’aime plus, ouin-ouin..." "Eh bien, ferme ta gueule, arrête d’être minable et dis-lui d’aller se faire enculer’ (rires)... Mais là, je me suis retrouvée face à des gens au plus mal, j’étais au bord des larmes, vraiment secouée. J’étais si impuissante à les aider. Je suis sortie bouleversée.
On ne choisit pas son public. Je suis certain que des garçons pervers ont accroché ta photo au-dessus de leur lit.
J’ai sorti mon premier album à 11 ans. En Islande, ça a été un tube énorme et je me suis soudain retrouvée sous les projecteurs. Sur l’île, tout le monde avait entendu parler de moi, me reconnaissait dans la rue. J’ai appris très vite à identifier mes vrais amis, mes vrais amours... je suis habituée : depuis longtemps à ce décalage entre ce que je suis et ce que les gens attendent de moi. Si certains me considèrent comme un sex-symbol, ça fait malheureusement partie du job. En tant que chanteuse, il faudrait que je sois vraiment un gros boudin pour y échapper (rires)... C’est amusant d’avoir sa photo accrochée au-dessus du lit des garçons. Pour eux, je suis en position de force parce que j’ai un micro dans la main. Ils ignorent tout de ma vulnérabilité. Du moment que je suis heureuse à la maison, ça ne me perturbe pas d’entendre mille types hurler mon nom à chaque concert.
Tu parles beaucoup de ta chance. Mais te sens-tu douée ?
Je mentirais si je n’avouais pas que certaines choses apparemment compliquées pour d’autres musiciens sont très faciles pour moi. Il m’est très facile de m’exprimer dans une chanson, beaucoup plus que dans la vie de tous les jours. Chacun sa façon de s’exprimer : certains de mes amis sont champions de ping-pong, c’est là qu’ils se sentent à l’aise, qu’ils se vident. Quand je sens que je n’arrive pas à formuler clairement ce qui ne va pas dans ma vie quotidienne, alors j’écris, c’est ma façon d’éliminer les problèmes de mon système. C’est une sorte de thérapie - je déteste ce mot -, mais sans la moindre logique, sans la moindre analyse. Car l’analyse détruirait mon instinct, toute créativité. Je ne veux surtout pas prendre le risque de savoir pourquoi et comment j’écris. Et si un jour la source se tarit, tant pis. Je deviendrai infirmière, comme j’ai voulu être fermière, tenancière de bar ou masseuse dans le passé.
Récemment, Tim Booth, le leader de James, déclarait que tu n’aurais jamais eu tant de succès sans ton physique. Le retour de bâton paraît inévitable après une année de louanges.
Tim Booth ? Ah oui, Sit down... C’est plus de la jalousie que du sexisme, non ? Le retour de bâton, je l’ai déjà vécu avec les Sugarcubes. Notre premier album avait été totalement surestimé, le second a été parfaitement sous-estimé. Je sais que 6o % de mon succès actuel est le fruit d’une mode, d’une hype. Je sais pertinemment que la critique fera la fine bouche ou qu’elle me cassera avec mon prochain album. Car l’année prochaine, je ne serai plus la bonne personne au bon endroit au bon moment.
Ta position est ambiguë : tu dénonces le sexisme, mais tu acceptes de poser comme une poupée de mode.
Quand j’étais gamine, je détestais voir ma photo dans les journaux, sur les pochettes de disques. J’avais l’impression de trahir la musique en posant ainsi. Après ce premier album, je me suis juré de ne jamais rejouer le jeu de la célébrité. Dans les groupes qui ont suivi, mon seul désir était de me cacher derrière. Mais avec les Sugarcubes, le cirque a recommencé. On voulait absolument me mettre en avant, me faire poser seule. Il m’a fallu des années pour accepter que ça faisait partie du boulot. Du moment qu’on ne touche pas à ma musique, je dois faire quelques petits compromis : c’est une façon d’acheter ma liberté tout en ayant l’impression de m’amuser.
Pourquoi était-ce si dur à 11 ans ? La gloire est le rêve de beaucoup de gosses.
A l’école, j’étais toujours au fond de la classe, je menais ma petite vie, j’avais mes secrets. Et là, soudain, je me suis retrouvée au premier rang, en pleine lumière. A la fête de fin d’année, devant les parents, les autres gosses montaient des tours de magie, un spectacle de gymnastique. Moi, je chantais. Une maison de disques islandaise a réalisé qu’il y avait beaucoup d’argent à gagner avec les disques d’enfants, ils ont envoyé des espions dans toutes les fêtes d’école. C’est ainsi que j’ai été repérée. Ils ont été corrects avec moi : ils m’ont laissé choisir les chansons que j’allais interpréter, j’en ai même composé une moi-même. Avec ma mère, nous avons fait le tour de l’île, afin de rencontrer tous les songwriters islandais. J’ai récolté une centaine de chansons, je n’avais plus qu’à choisir. J’ai vraiment été une enfant gâtée. J’ai appris à me servir d’un studio, de tous ces gadgets... J’avais l’impression de visiter Disneyland (sourire)... Pour une petite fille obsédée de musique comme je l’étais déjà alors, c’était le paradis.
Tes parents étaient-ils derrière toi ?
Ma mère était aussi heureuse que moi. Mes parents venaient de familles de travailleurs, élevés à la dure. Du côté de mon père, ils étaient tous électriciens ou fermiers. Chez ma mère, ils étaient maçons ou ébénistes. Uniquement des métiers manuels. En Islande, ça fait partie du tempérament de bosser dur pendant douze heures d’affilée, c’est un gage de bien-être. Mais quand j’ai eu un an et demi, ma mère a craqué. Elle n’en pouvait plus de mener cette existence laborieuse, de rester à la maison, de cuisiner et de se faire belle en attendant le retour de l’homme. C’était en 68, les femmes aspiraient à autre chose. Beaucoup de femmes ont quitté le pays, c’est pour ça qu’une de mes tantes vit en France, à Gex, depuis l’âge de 16 ans. Ma mère a quitté mon père et est partie vivre dans une communauté hippie. Elle avait les cheveux les plus longs de toute l’Islande (rires)... Ils vivaient à douze, j’étais le seul enfant. Le jour, ils travaillaient, mais la nuit, nous étions tous ensemble, à écouter Hendrix, Janis Joplin, Cream... Une drôle d’éducation, entre ma mère qui refusait la tradition et un père très rigoureux, sérieux, croyant à l’honneur et à la discipline. Avec les hippies, tout était permis. Il suffisait qu’un dise "Ça souffle dehors, allons jouer au cerf-volant" pour qu’ils se lèvent tous en courant, pieds nus et cheveux au vent. J’ai eu la chance d’avoir été confrontée à ces deux modes de vie totalement opposés. Chez ma mère, j’étais l’égale des adultes, on me parlait comme si j’étais l’une d’entre eux. Dès 4 ans, j’étais parfaitement libre : je pouvais prendre le bus pour aller voir ma grand-mère ou mes tantes, traverser l’île en auto-stop... Ma famille compte des centaines de membres, j’aimais leur rendre visite, les observer dans leur vie quotidienne si différente de la mienne. Car tous travaillaient dur, avec des principes rigides :"II faut bosser dur, aimer sa femme"... Je crois qu’ils étaient choqués de me voir pieds nus, ma robe toute sale, les cheveux crasseux, de constater à quel point j’étais livrée à moi-même. J’ai vite été autonome, me débrouillant seule pour les devoirs, les transports, la nourriture. Ils ne comprenaient pas que ma mère me donnait tout ce dont j’avais besoin : du soutien et de l’amour.
Étais-tu consciente de ne pas recevoir une éducation très orthodoxe ?
J’allais à l’école, comme les autres. Dans ma classe, tout le monde rêvait de venir me rendre visite chez ma mère. C’était pour eux un lieu magique, plein de hippies qui adoraient jouer avec les gosses. On en trouvait toujours un pour une partie de frisbee ou pour nous aider à construire un igloo. Ça, les autres enfants n’auraient jamais cru que ça pouvait exister. Je ne réalisais pas vraiment à quel point c’était unique. Pour moi, ma mère était super, point à la ligne. Quelquefois, bien sûr, j’en souffrais un peu. J’aurais parfois voulu rentrer et ne pas avoir à cuisiner. Alors je rêvais d’une mère parfaite, une mère qui me mette des chaussettes propres quand j’ai froid aux pieds, qui me fasse un bol de chocolat quand je n’ai pas le moral... Pour avoir tout ça, j’allais chez ma mémé (sourire)...
Tu devais te sentir beaucoup plus adulte que les autres enfants.
Je passais ma vie avec des adultes, qui aimaient que je participe aux discussions, pour avoir l’avis d’un candide. "Quelle est la couleur de Dieu à ton avis ?" Les hippies adorent ce genre de débats (rires)... J’avais une vision d’ensemble plus large que les autres écoliers, souvent incapables de comprendre ceux d’entre nous qui étaient un peu en marge. Par exemple, tout le monde se moquait d’un pauvre gars qui collectionnait les insectes. Tous pensaient que c’était un pauvre con, sauf moi. La limite entre ce qui est bien et ce qui est mal était moins rigoureuse pour moi que pour les autres. Je fréquentais aussi bien les cancres - ceux qui faisaient sauter la salle à manger de leurs vieux en faisant des expériences de chimie ou fumaient de la dope - que les premiers de la classe, je les aimais tous. Et pourtant, en même temps, j’étais solitaire, l’excentrique de l’école. Les profs me laissaient agir à ma guise, vu que je travaillais bien et qu’ils connaissaient mon besoin d’indépendance. Ils m’autorisaient à sécher la plupart des cours, pour que je me concentre sur du travail à la maison. En maths et en physique - mes matières préférées -, je ne venais qu’une fois par semaine. Le prof me donnait des recherches à effectuer, je lui ramenais mes résultats la semaine suivante. Une parfaite flexibilité de mes horaires de travail. Je ne luttais pas contre le système, je le tordais pour qu’il s’adapte à moi. En fait, j’adore les systèmes, les contourner, les adapter. Comme le milieu du disque (rires)... C’est formidable de slalomer entre les règles.
L’lslande était un pays effroyablement pauvre jusqu’à ce siècle, pire encore que le tiers-monde - le quart-monde. Et soudain, des imbéciles ont décidé de nous enrichir. Eux en faisant la guerre, nous en leur vendant le poisson qu’ils n’avaient plus le temps de pêcher. Le changement a été incroyable. Travailler dur est inscrit dans nos gênes : quand tu manges d’une main, tu répares le mur avec l’autre (elle mime le marteau)... Les Islandais sont des fous de travail, qui construisent eux-même leurs maisons, cousent leurs propres vêtements. S’ils n’y arrivent pas, ils sont considérés comme des pauvres types, des losers. L’optimisme est une chose revendiquée, parfois même violemment. "’Tout va bien, tout ira bien" (elle prend un air féroce)... Si tu ne te bats pas, tu meurs gelé en moins d’une semaine. S’apitoyer sur soi-même est le crime suprême. Un type comme Morrissey, qui admet ses propres doutes et ses faiblesses, serait condamné à mort en Islande.
Pourrais-tu revenir y vivre après avoir voyagé dans le monde entier ?
Beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet, des scientifiques en débattent : pourquoi les Islandais reviennent-ils toujours sur l’île en fin de compte ? Pourquoi ce besoin vital de retour aux sources ? L’étranger, c’est bien pour étudier, pour travailler quelques années mais à l’arrivée, je connais beaucoup de gens qui ont sacrifié une carrière prometteuse à l’étranger pour rentrer au pays, quitte à travailler dans une poissonnerie industrielle. Ça fait un an que j’habite à Londres et je sais pertinemment que je ne me sentirai moi-même qu’en Islande. Je ne regarde pas les Anglais de haut, mais nous n’avons pas la même mentalité. Même leur humour est différent, très négatif, très ironique. Ils se moquent de tout, de tout le monde - y compris d’eux-mêmes. Ce côté blasé me rendait folle au début. Sans enthousiasme, je suis perdue. Et eux sont si subtils, si civilisés, si polis... Ils ne montrent jamais le moindre signe d’émotion. Alors que moi, je m’emporte, je suis plutôt démonstrative (elle mime)... En fait, j’ai beaucoup plus en commun avec les Européens du Sud, comme les Espagnols, avec leur énergie primitive. "Super, allons nous saouler, puis on travaillera quinze heures d’affilée, puis nous ferons l’amour neuf fois de suite !" (rires)... Les Anglais sont incapables de suivre ce rythme. A Londres, le sentiment de communauté me manque terriblement, je ne pourrai jamais rompre les ponts avec l’Islande. Mes copains, je les connais depuis ma plus tendre enfance, j’ai du mal à vivre sans eux. Surtout sans leur sens de l’humour... Un humour très dur, à l’optimisme très agressif. Il ne faut pas oublier qu’au début du siècle, la plupart des islandais habitaient dans des huttes de terre glaise, ils en ont tellement bavé avant de devenir riches que l’humour s’en ressent.
L’été dernier, tu es revenue au pays pour faire le tourde l’île à vélo. Etait-ce un besoin physique ?
J’ai toujours aimé voyager seule en Islande, à vélo ou en stop. Gamine, je prenais une tente et un sac à dos et je disparaissais pendant des semaines. J’adore rencontrer des gens nouveaux, surtout que je me sens parfaitement en sûreté sur l’île. Il n’y a pas encore de serial-killers islandais (rires)... Là, j’ai laissé mon petit garçon chez son père et pendant trois semaines, je suis allée de village en village à vélo. J’avais l’impression d’être seule au monde, sans le moindre bagage, comme dans un livre de Kerouac. Là-bas, chaque ferme possède sa propre église, parfois de la taille d’un placard. Les paysans les ont décorées de fresques naïves, magnifiques... Des petits Jésus tout souriants, adorables. Je demandais aux fermiers si je pouvais me recueillir chez eux. Je jouais de l’harmonium pendant des heures, enregistrant ces chansons sur mon dictaphone. C’est ainsi qu’est né The Anchor song. Ça n’avait rien à voir avec la religion - je ne crois pas en Dieu. C’était juste par amour de ces bâtiments, de ces harmoniums, de ma liberté. En échange, j’aidais les fermiers à faire les moissons. Et je repartais généralement avec un saumon sur le dos, mon salaire pour les avoir aidés à rentrer les foins. Je suis notamment restée trois jours chez un vieux type dont la seule passion était la confection de mouches de pêche à la truite. Des objets d’art.
Tu viens de vivre une année sur la route. Quand as-tu le temps de t’occuper de ton fils ?
Avant qu’il aille à l’école, il me suivait partout. Jusqu’à l’âge de 6 ans - la période la plus importante d’une relation mère-enfant -, nous ne nous sommes pas quittés. C’était parfois difficile de partir en tournée avec les Sugarcubes en emportant une malle de couches-culottes, mais je tenais à l’avoir près de moi. Aujourd’hui, je suis seul maître à bord. Je peux donc arranger les tournées pendant ses vacances scolaires. Je ne sais pas si c’est le fait d’habiter à Londres ou le résultat d’une année bien remplie, mais j’ai vraiment l’impression d’être devenue plus responsable... Comme si, soudain, je réalisais que mon innocence et ma naïveté étaient des privilèges. Les Anglais sont terribles pour te faire perdre ta naïveté. Tu leur montres la chose la plus incroyable - par exemple, Dieu descend du ciel et offre à chaque Anglais une tonne d’ananas - et ils te disent : "Ouais, pas mal, déjà vu" (rires)... J’ai très peur de perdre mon enthousiasme, de devenir blasée et cynique. Aujourd’hui, si je voyais des gamins plonger du haut d’une falaise, j’aurais tendance à leur dire "Les gars, vous allez vous faire mal." Il y a un an, je les aurais immédiatement rejoints au bord du précipice pour sauter.