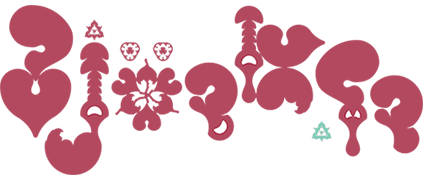Pop-music. Avant-garde. En chiens de faïence, l’un et l’autre bien campés sur leurs rives, refusant le dialogue, pimbêches et culs serrés, trop triste. Il n’y a pas si longtemps, ce petit monde partouzait plus allègrement encore que chez Catherine Millet, sans devoir fournir de pedigree, d’attestation d’origine contrôlée : des Who aux Beatles, des Beach Boys au Velvet, il fut un temps où l’avant-garde regardait d’un peu moins haut les mauvaises manières de la musique populaire, où tous ensemble partaient danser à Top of the Pops et allaient au cul joyeusement après. On ne se posait pas de questions : la libération sexuelle s’appliquait logiquement aux musiques.
Puis arriva le retour de manivelle post-flower power et son puritanisme vengeur, qui se chargea de renvoyer tout le monde dans son dortoir : la pop-music en bas de l’échelle et les avant-gardes sous les toits.
Ceux qui débarquèrent à ce moment-là dans la musique eurent une veine incroyable : le premier à les prendre par la main pour leur faire visiter le labyrinthe s’appelait David Bowie. Et il avait de la discipline et de la hiérarchie des genres une horreur érigée en principe.
Chacun des nouveaux albums de Bowie ramenait dans le vocabulaire usuel des noms qui, sans lui, seraient sans doute bêtement restés confinés à l’underground : on voyait que Roxy Music assurait sa première partie et on achetait Roxy Music ; on lisait que le membre préféré de Bowie dans Roxy Music sortait un disque solo et on achetait du Brian Eno ; on lisait que Bowie allait produire Lou Reed et on achetait le Velvet Underground. Il évoquait sa technique de collage et on lisait Burroughs. On lisait que le membre préféré de Bowie dans le Velvet était John Cale et on achetait Paris 1919. Plus tard, on apprit que Bowie était parti à Berlin pour retrouver les ambiances de Kraftwerk et on acheta du rock allemand. Tout ça pour dire que beaucoup lui doivent des découvertes précieuses, déterminantes même : ces musiciens sur lesquels on a pu bâtir une mythologie personnelle et tout ce qui allait en découler n’auraient jamais été entendus sans cet infatigable passeur d’idées, d’une rive à l’autre.
Aujourd’hui, on se demande franchement si les noms de Tricky, Goldie, Leila, Howie B, Sigur Rós, Aphex Twin, Matmos ou Funkstörung (la liste est longue) seraient aussi diffusés s’il n’y avait pas eu une autre increvable tête chercheuse, une autre ambassadrice sans œillères pour les ramener de ses voyages dans l’underground. Car Björk est, depuis Bowie, la plus impressionnante passerelle qui relie ces deux rives entre lesquelles l’espace n’a cessé, depuis la fin des sixties, d’augmenter.
En 1993, Björk connaissait bien évidemment Bowie. Et Bowie connaissait forcément Björk, alors pourtant inconnue du grand public. Car Bowie, après être entré en hibernation pendant dix ans, retrouvait son instinct de chasseur de têtes, se remettait à traquer dans les avant-gardes ce qui pourrait à nouveau faire dérailler sa pop-music quadra. L’un et l’autre ne se sont à l’époque jamais rencontrés ailleurs qu’à la lettre B de notre discothèque, de notre Panthéon personnel, mais la similitude de leur discours est troublante. Ainsi parlait alors Bowie de sa vision de la musique populaire, quand on lui demandait s’il se sentait bien dans son rôle de passeur. “Je ne fais pas ça pour être en avance sur tout le monde, mais uniquement parce que je suis poussé par une incurable curiosité pour tout ce qui est nouveau. Au sens le plus pur du terme, je suis un avant-gardiste. J’aime observer la façon dont avancent la société et la culture. Ce qui me sidère, ce sont les gens qui ne recherchent plus ces informations, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Si j’ai un talent, c’est celui-là : reconnaître ce qui est important et ce qui ne l’est pas. J’ai compris très jeune que ce qui était fondamental pour la société venait toujours de sa périphérie. C’est pour ça que je voulais lire Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti : parce qu’ils vivaient et écrivaient en marge. Ils étaient ma fenêtre sur la [3].”
Dans un ping-pong à distance, Björk répondait ainsi, à quelques semaines d’intervalle, à la même interrogation sur le divorce entre le mainstream et l’underground. “Je veux m’approcher d’une pop-music à la fois expérimentale et parfaitement accessible. L’attitude de Stockhausen et les refrains de Boney M… Des compositeurs comme Stockhausen, Schoenberg, Messiaen ou Debussy ont énormément en commun avec la pop-music la spontanéité ou le refus de la tradition. La pop-music devrait être ainsi, ça m’énerve de la voir se limiter à un solo de guitare ou à un son de boîte à rythmes. Comme le jazz, la pop est devenue une formule, une musique figée. Où sont passées l’ouverture d’esprit, l’aventure ? On va aujourd’hui à l’école pour étudier le jazz ou le rock comme s’il s’agissait de langues mortes. Pourtant, beaucoup de musiciens pop sont fans de ces compositeurs. Lennon, par exemple, était un grand fan de Stockhausen [4].”
Lennon fut aussi, le temps d’un Fame précurseur de tout un pan du disco blanc-bec, le collaborateur de Bowie. On évoquait précédemment les ponts, les passerelles entre deux mondes distincts. On sait, pour très bien connaître la Transylvanie, que c’est sous les ponts que vivent les vampires : c’est sans doute ici que s’arrête la comparaison entre Bowie et Björk. Car on a régulièrement douté de la sincérité de Bowie, toujours prompt à se payer une crédibilité sur le compte de l’air du temps. En ce sens, son cinquantième anniversaire, fêté en grande pompe au Madison Square Garden de New York, fut un monument de cynisme : on le vit alors partager ses miettes de gâteau avec Sonic Youth, Frank Black, Placebo ou les Smashing Pumpkins.
Le cynisme est, chez Bowie, un authentique talent : celui de toujours se faire photographier au bon bras au bon moment, que ce soit celui d’Iggy Pop ou des Pet Shop Boys, de Lou Reed ou de Morrissey, de Scott Walker ou de Kraftwerk. Car si Bowie a apporté beaucoup de sang neuf dans nos discothèques débutantes, c’est surtout parce qu’il en suçait beaucoup lui-même. Un vampire cependant assez généreux et droit pour ne jamais oublier de renvoyer l’ascenceur à ses victimes même exsangues.
A côté d’un tel monstre sanguinaire, Björk fait aisément figure d’ange végétarien. Il ne faut pourtant pas s’y tromper : même fidèle en amitié dans ses collaborations, Björk peut elle aussi régulièrement faire figure de mante religieuse, gourmande et volage. Pourquoi alors ne nous viendrait-il jamais à l’idée de la considérer comme une cynique, une récupératrice ? En raison d’un dessein fondamentalement opposé à celui de Bowie : de ces avant-gardes ainsi sucées, dépouillées, Björk nourrit uniquement sa musique. Alors que Bowie, lui, en nourrissait son ego boulimique autant que ses disques.
Si Björk possède sans doute le plus prestigieux carnet d’adresses de la musique d’aujourd’hui, c’est surtout que ses emprunts ont alimenté des disques indiscutables, ne voulant que du bien à la musique et donc à l’humanité. On ne peut pas ainsi faire l’unanimité aussi bien dans l’electronica la plus snob que dans le jazz le plus téméraire, le rock le plus cascadeur ou la variété la plus revendiquée en étant une simple traductrice des idées neuves en idées mâchées, banalisées. On ne s’attache pas les collaborations aussi courues que rares d’électrons libres comme Alec Empire, Alan Braxe ou Aphex Twin tous particulièrement vigilants sur leur récupération sans le mériter. Et pour tous ceux qui désirent vraiment que change la musique (on ne parle pas des snobinards d’un underground à l’odeur de chaussette), pour tous ceux qui sont partis en croisade contre la facilité cossarde de la pop-music, Björk demeure le meilleur étendard possible, la plus efficace porte-parole.
On entendait récemment Brigitte Fontaine, qui en connaît un rayon sur les équilibres casse-cou entre underground et variété, chanter, en compagnie de Sonic Youth (oui, le groupe du cinquantième anniversaire de Bowie) : “Je glisse dans les rues fardée, mon clair flacon entre les doigts en écoutant Björk et Fauré.” Björk et Fauré sur l’autoradio : sur ces ponts d’opinion, on y danse, on y danse.